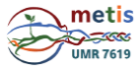La Fédération de Recherche (FR-3020) FIRE (Fédération Île-de-France de Recherche sur l’Environnement) créée en janvier 2007, a pour vocation essentielle de promouvoir la recherche interdisciplinaire dans le domaine des Sciences de l’Environnement. Son projet fédératif concerne principalement des travaux de recherche relevant des surfaces continentales (bassins versants et réseaux hydrographiques, lacs et réservoirs, parcelles agricoles et forêts, petites régions agricoles, paysage) et de leurs interfaces avec les eaux souterraines sous-jacentes, les zones marines côtières et l’atmosphère.